(Edition Les Liens qui Libèrent, janvier 2025) – Eric Debarbieux
Rappeler les « Valeurs de la République » pourquoi pas ? Mais la ritournelle moralisante n’est pas d’une grandiose utilité si l’on en croit les évaluations de programme contre la violence et les addictions[1] qui montrent qu’ils peuvent renforcer les conduites négatives chez les élèves les plus éloignés de l’ordre social : puisque le policier, le professeur, l’adulte me dit de ne pas le faire alors je dois le faire pour être un homme ! Plus communément la simple interdiction et trop d’intrusion dans l’imaginaire et la socialité adolescente peut avoir des effets contraires à ce qui est souhaité. Ainsi les travaux sur la cyberviolence montrent bien à la fois la supériorité d’une approche par le dialogue en particulier en famille, sinon les jeunes concernés prendront plus de risques dès que la supervision parentale se sera éloignée.
Comme l’écrivait Françoise Lorcerie après les attentats de Charlie-Hebdo et de l’hyper-cacher[2] « aujourd’hui, qui sait comment faire nation ou faire communauté avec des membres qui ne s’aiment guère, dont certains estiment que les autres n’ont rien à faire ici ? Tel est le défi que devra relever une réaction pertinente à ces attentats. » Et cela touche au rôle de l’École. Ce n’est pas une question de laïcité mais d’appartenance. Lorcerie le rappelle : Les trajectoires criminelles des Kouachi et de Coulibaly montrent qu’avant de virer dans le djihadisme, brutalement, ils étaient bien loin d’être des zélotes de la religion, ils étaient dans la désappartenance. Retournons le vieil argument mussolinien, largement repris par Le Pen. Avant de me sentir membre de la Nation, de la République, je dois me sentir membre de cette école, dans mon quartier, qui est dans ma ville, partie de ma République.
Plutôt que de grands discours, des minutes de silence (tout à fait justifiées cependant), et beaucoup plus modestement il s’agit de faire, plutôt que de dire. Et cela passe par du bien plus trivial, un accueil beaucoup plus attentif aux besoins fondamentaux de l’enfance, y compris sur le plan corporel. Car rappelons-nous une fois de plus d’un fait très simple : la violence en milieu scolaire est massivement une violence interne, constituée essentiellement de microviolences répétées, exercées par des élèves et parfois des personnels contre d’autres élèves et parfois des personnels. La lutte contre le harcèlement et les violences à l’École doit être incluse dans le fonctionnement ordinaire. Si des programmes extracurriculaires peuvent être efficaces, avec une aide de personnes ressources et d’institution extérieures, il n’en reste pas moins que rien ne peut réussir sans une mobilisation collective des équipes et une adhésion effective du chef d’établissement. Cette mobilisation n’est pas forcément une mobilisation directe autour du harcèlement, du sexisme ou de la violence. Pour ma part je préconise, et depuis longtemps, des stratégies indirectes. Tout focaliser sur une dramatisation du harcèlement finit par lasser, sans doute, et par affoler, mais aussi contribue à le séparer de l’ordinaire prévention, de la prévenance, de l’aller vers l’autre dans la vie quotidienne. Bien des expériences montrent que c’est l’augmentation de la qualité du « vivre-ensemble » qui est déterminante. Cette qualité ne dépend pas de mesures spectaculaires : la convivialité entre adultes, la qualité d’accueil des familles dans des occasions festives, la qualité de la cantine, la propreté des toilettes (et l’autorisation de les utiliser !), les rituels d’entrée et de sortie de classe ou de l’école, la distribution de la parole parmi bien d’autres actions minimes ne sont évidemment pas des solutions miracles, mais sont des conditions nécessaires. Le but de ce texte n’est pas de décrire ces interventions pédagogiques, mais il faut bien souligner que ce sont d’elles que découle le sentiment d’appartenance à une communauté éducative qui est un élément du cercle vertueux se créant dans une école, tant pour les élèves que pour les adultes. Ceci peut sembler trivial, mais le tort est de croire que pour résoudre un problème il faut avoir une intervention aussi grande que la cause ! Et cela ne se décrète pas depuis le haut de la pyramide. Cela ne se réalise pas par circulaires. L’invitation au travail collectif incluse dans la notion de climat scolaire devient une cause de refus de ce travail en commun quand elle devient une injonction hiérarchique, dont le côté paradoxal du « soyez autonome » a été énoncé dans ce livre en même temps que l’inflation terrifiante de textes réglementaires et de circulaires.
de cette discrimination, étant tout autant liées à la situation internationale, mais une violence que nous nourrissons.
Ce n’est pas très optimiste ? Raison de plus pour agir. Si ce combat est le combat de Sisyphe poussant sa pierre, il n’en reste pas moins le grand combat humain.
[1] J’ai en particulier mis en avant les évaluations d’un des plus célèbres programmes de ce genre aux USA, le programme D.A.R.E. cf. Debarbieux (2006)
[2] Lorcerie, F. (2015). « Cesser de jouer avec la laïcité », Huffington Post, mai 2015

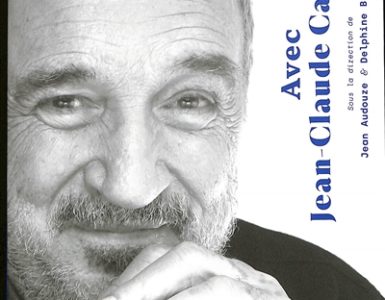
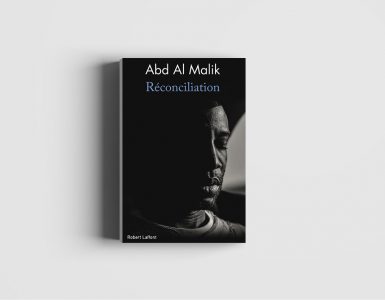
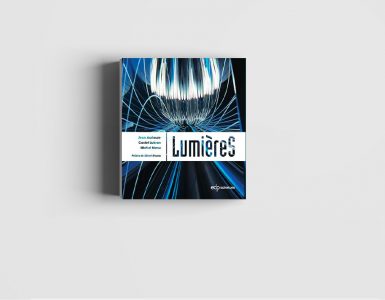





Commentaires récents